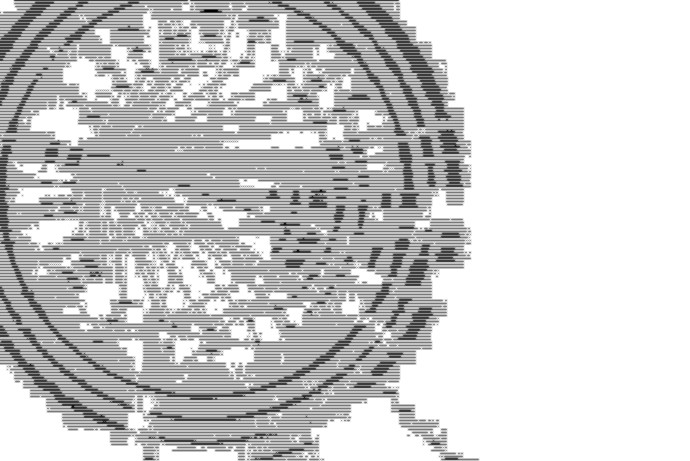
Picky Stickers n°2 : journalisme, investigation Femmes et décolonialismeS
- 7 minsJ’ai l’espoir et un de plaisir de continuer #note « Picky Stickers » dédiée à l’investigation. ET suivant Picky Stickers n°1 : origines (floues) du journalisme d’investigation et initiatives dés-Occidentales.
Le prisme occidental pèse très lours dans les approches investigatives (journalismes, sciences, pratiques dites citoyenne, reportages) et le moyens techniques de productions comme les infrastructures sont aussi fortement et lourdement Nordistes.
USA colonisé, mais rebellé ? Ou pas… car dans les faits sur lesquels j’ai pu travailler il est évident que les origines et les investigations en tant que pratiques viennent aussi d’avant les USA et d’ailleurs ! L’investigation reportée et tentée en méthode est au moins issue du IVe siècle avant l’ère commune depuis le sud de l’Inde actuelle.
L’actualité et la géo-politique actuelle reflète ces inclinaisons. Cependant d’autres faits et d’autres histoires existent.
Genre(s) et couleurs de peaux
TL;DR: Oui les hommes CIS blancs sont trop, beaucoup trop présent dans toutes les écritures accessibles à ce jour.
Aux USA, Ida Bell Wells-Barnett, aussi nommée Ida B. Wells, était une journaliste afro-américaine, rédactrice en chef et propriétaire d’un journal (avec son mari), le Memphis Free Speech. Installée à Memphis, elle est confrontée à la ségrégation raciale autorisée par les lois Jim Crow. En 1884, elle assigne en justice la Chesapeake and Ohio Railway pour ségrégation et devient journaliste pour la dénoncer, avec le nom de plume Iola. En 1892, révoltée par les lynchages de “People’s Grocery Company”, elle s’engage dans le journalisme d’investigation et publie deux longues brochures de pages documentées et avec des statues: Southern Horrors : Lynch Law in all its phases (1892) et The Red Record (1894).
L’investigation en tant que mouvement de production et de postures diverses et variées doit aussi beaucoup à Elizabeth Jane Cochrane, dite Nellie Bly, qui raconta la vie de ouvrières et les conditions de travail dans une conserverie en 1880. Elle publia dans The Pittsburgh Dispatch, qui était alors dirigé par J. Heron Foster, opposant farouche à l’esclavage.
Femme et orpheline, Nellie Bly fait face à des discriminations et des ségrégations. C’est une tribune sexiste publiée dans The Pittsburgh Dispatch qui la pousse à écrire au rédacteur en chef George Madden.
Activiste et pratiquante de l’investigation infiltrée, À 23 ans, se fera interner 10 jours dans un asile d’aliénées, Blackwell’s island (1839 - 1894) situé à New York sur une petite île au large de Manhattan (>cite>Nicole Edelman</cite> (2015)). C’est son rédacteur en chef, Joseph Pulitzer, qui lui conseilla de faire cette investigation par internement. Il est bien bien différent d’être interné⋅e sous contrainte que d’être intrné⋅e de force.
Nellie Bly fait de l’investigation aussi
Les premiers journaux africains remontent au début du 19e siècle avec l’arrivée de missionnaires. La Cape Town Gazette, premier journal anglais, est apparue en 1800 en Afrique du Sud, et la Royal Gazette en 1801 en Sierra Leone. Le premier journal dit autochtone, le Liberia Herald, a été fondé en 1826. Au Ghana, le West African Herald a vu le jour en 1857, jusqu’au au Nigeria avec l’Iwe Irohin a fait son apparition en 1859 (Ntibinyane (2018)).
L’ascendance anglophone est ici très présente.
La colonisation, notamment celle Anglaise, a mené à une domination par la langue jusqu’au écriture et publications des travaux sur les libertés et contre pouvoirs.
Le premier journal Black d’Afrique du Sud, Imvo Zabantsundu (Black Opinion), a été publié à King William’s Town en 1884 sous la direction de Tengo Jabavu comme rédacteur en chef. C’est le premier journal bantou indépendant.
Missionary owned newspapers later led to the emergence of more radical indigenous and African owned newspapers. It was these newspapers that would later play a key role in speaking against colonialism and calling for independence.
Ntibinyane Ntibinyane, 2018
“That the rise of newspapers was entangled with that of other colonial institutions produced strange tensions since many newspapers ended up being part of the vanguard of independence movements.”
Lugalambi Schiffrin, cited by Ntibinyane Ntibinyane
Le journalisme d’investigation structuré, ou disons dans son acception moderne, semble voir le jour dans le continent Africain lors des années 1960 et 1990, après la fin de l’ère coloniale et des régimes autoritaires. La fin de l’apartheid en Afrique du Sud et la fin des régimes autoritaires au Ghana, au Mozambique et au Nigeria ont également ouvert les médias dans ces pays (Ntibinyane (2018)).
Dans un contexte plus large où aujourd’hui le Nord global représente 93 % des publications dans le domaine des études sur les médias et la communication.
L’Arthashâstra, traité politique et écrit important en sanskrit, datant du IVe siècle avant l’ère commune et sud de L’Inde actuelle peut être considéré comme un traité de l’investigation produisant de l’information (Siddharth Negi (2018)).
Les premiers journaux africains remonteraient au début du 19e siècle en concomitances d’arrivée de missionaries. La Cape Town Gazette, premier journal anglophone, est apparu en 1800 en Afrique du Sud, et la Royal Gazette en 1801 en Sierra Leone. Le premier journal dit autochtone, le Liberia Herald, a été fondé en 1826. Au Ghana, le West African Herald a vu le jour en 1857, jusqu’au au Nigeria avec l’Iwe Irohin a fait son apparition en 1859 (Ntibinyane (2018)).
https://xavcc.frama.io/picky-stickers-n-1-journalismes-investigations-hors-occident/
Selma Rıza (1872 - 1931) est aussi un femme qui a construit le journalisme. Elle s’est efforcée sur l’inclusion des femmes musulmanes, pionnière du Ottoman Women’s Movement. + Il y avait aussi en ce temps de l’empire Ottoman le Hanımlara Mahsus Gazete (1895 - 1908), journal « féminin » qui traitait de culture et de droit des femmes en essayant de ne pas énerver la censure de l’époque.
May Elias Ziadeh (1886-1941) journaliste palestinienne-libanaise, écrivaine, poétesse.
Gifty Afenyi-Dadzie (née en 1957) journaliste ghanéenne, spécialiste des médias, femme d’affaires et a été la plus ancienne présidente de la Association des journalistes du Ghana.
Sokhna Dieng Mbacké (née en 1950) une journaliste et femme politique sénégalaise.
Il est évident que je couvre ici pas toutes les personnes ni tous les profils depuis les 19e jusqu’à la moitié du 20e et cela n’est pas mon but. Je tente d’ouvrir une des voies possibles pour des dialogues et des perspectives ouvertes et pls équilibrées si cela est un possible.
Décolonisations sont plurielles
Il n’y a pas « une » mais « des » pensées décoloniales. Selon les auteurices du livre « Critique de la raison décoloniale », un courant en particulier, né dans les universités étasuniennes et influent sur le continent américain, s’accapare toutefois le domaine. La sortie de l’ouvrage en français est l’occasion pour l’historien Jérôme Baschet d’identifier les nœuds de cette controverse et d’appeler à un débat plus ample.
https://leftrenewal.org/fr/book-reviews-fr/baschet-malaise-dans-la-decolonialite/
et aussi :
-
France: programme des Rencontres décoloniales rurales est sorti ! - 17 et 18 mai 2025 à Aouste-sur-Sye
-
Data colonialism: ‘The data from a colonizing country colonizes the land, water and energy of a poor country.’ https://gerrymcgovern.com/data-colonialism/
-
Manuela Picq - What lessons can activists/resistance around the world learn from Ecuadorian water defenders? by EXALT Podcast https://creators.spotify.com/pod/profile/exalt-initiative/episodes/Manuela-Picq---What-lessons-can-activistsresistance-around-the-world-learn-from-Ecuadorian-water-defenders-e31v2g7
D’autres publications et surtout travaux de fonds sont à venir, j’espère vous lire et vos retour. Si vous avez quelques 50 centimes en poches, votre don sauvera un peu *autant que faire se peut ma santé :-)
Merci à toutes les personnes qui soutiennent les efforts par leurs dons

Xavier Coadic
Human Collider